La part sauvage du monde : Penser la nature dans l’anthropocène
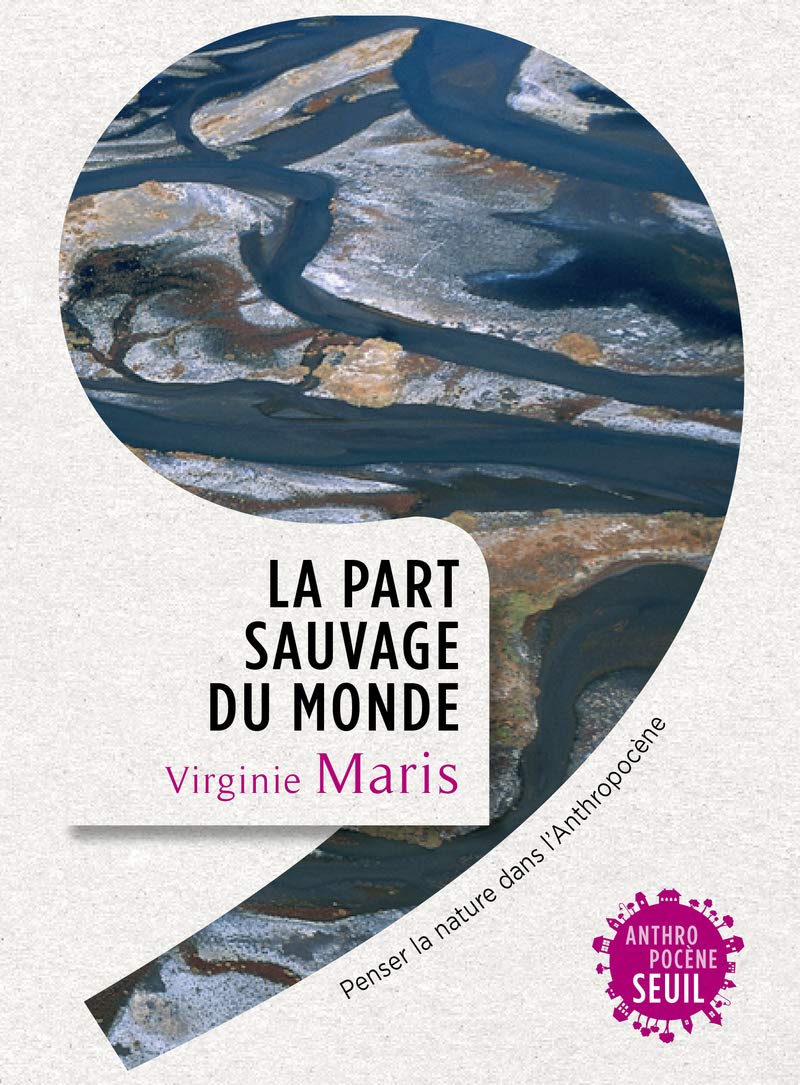
Notre vision de la nature est fortement marquée par la vision d’humains ayant pris les commande d’un système Terre qu’ils modèlent comme ils le souhaitent « Nous voilà entrés, et avec nous la Terre tout entière et chaque être qui la peuple, dans l’ère de l’humain, l’anthropocène. Les paysages, les océans et l’atmosphère ne sont plus la toile de fond transcendante et immuable des activités humaines. Ils en sont devenus un sous-produit accidentel qu’il convient de gérer rationnellement ».
Au rebours de cette vision anthropocentrée, le but de l’ouvrage de Virginie Maris est de réhabiliter l'idée d'une « part sauvage du monde » qui échappe au contrôle des humains.
Ainsi, pour l’auteure, toutes les prises de conscience et actions écologistes, censées « protéger » la Terre, ont été et sont encore, paradoxalement, des entreprises de domination. En effet, à force de substituer à la réflexion sur nos relations avec les non-humains celle sur la protection de la nature, on finit par ne plus parler que des seuls humains.
Les deux premières parties sont consacrées à l’évolution du concept de nature : « La nature est un concept, pas un simple nom que l’on aurait donné une fois toute à une réalité tangible, mais un terme abstrait construit dans la culture et dans le langage, et dont le contenu immanquablement, varie à travers les cultures et à travers des langages ».
Retraçant l’histoire de la relation à la nature, depuis le « devenir maître et possesseur de la nature » de Descartes jusqu’à la révolution industrielle du XIXe siècle, l’auteure analyse le « grand partage » entre nature et humains et l’ensemble des approches philosophiques au cours de l’histoire, allant jusqu’à « la fin de la nature ».
La troisième partie est consacrée à « l’absorption » de la nature par les humains : elle analyse « comment l’étude et la protection de la nature elles-mêmes contribuent à la fin de la nature en précipitant l’engloutissement de la part sauvage du monde dans l’agir humain ».
Il s’agit de l’absorption technique, où l’humain essaye de reconstituer la nature et où l’on n’arrive plus à faire la différence entre naturalité et artificialité. Il ne faut pas chercher à « fabriquer la nature », mais plutôt à « l’accompagner dans ses méandres » ou à « réparer çà et là des dommages afin qu’elle reprenne sa route ».
L’absorption économique, c’est la marchandisation de la nature avec le développement des concepts de « capital naturel » et de « service écosystémique », ainsi que la montée en puissance des outils de conservation inspirés du marché ;
L’absorption bureaucratique, c’est la multiplication des dispositifs de suivi et la gigantesque accumulation de données sur les systèmes écologiques à tous les niveaux d’organisation et à toutes les échelles spatiales : « il s’agit de l’intégration de la nature, de tous ces éléments et de tous ces processus, dans un régime de surveillance généralisée qui procède peu à peu à l’effacement du souci pour les phénomènes eux-mêmes au profit d’une attention toujours plus grande aux données qu’elle génère ».
Dans la dernière partie, Virginie Maris fait un plaidoyer pour la part sauvage du monde , « celle qui n’est pas intentionnellement fabriquée ou transformée par les êtres humains » et qui se caractérise par trois spécificités : son extériorité, son altérité, et son autonomie.
« Penser l’extériorité de la nature, c’est accepter de se donner des limites, de border notre empire », de reconnaitre qu’il existe un monde en dehors des affaires humaines. Reconnaître l'altérité de la nature, c'est admettre l'hétérogénéité radicale qui existe entre les affaires humaines et le monde sauvage et que ce monde sauvage n’est pas uniforme, c’est un « enchevêtrement de vies, de relations, de perspectives » . Enfin, il nous faut respecter son autonomie et considérer notre relation aux animaux sauvages « non plus seulement comme un lien à des individus particuliers, mais vis-à-vis de communautés ayant leur propre fonctionnement et réalisant des finalités qui nous échappent ».
En conclusion l’auteure nous rappelle que « Inventer des façons plus douces de cohabiter avec le vivant monde est donc un enjeu essentiel pour la protection de la nature autant que pour le bien-être humain » . Et elle nous parle du besoin d’humilité, car « préserver la nature sauvage, c’est accepter de lâcher prise et s’affranchir du désir de contrôle ».
C’est aussi « notre seule chance de sortir de la trajectoire mortifère que l’orgueil et la cupidité de certains ont imposé à la société toute entière ».


